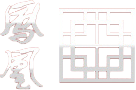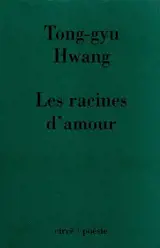Entretien avec Kim Hyunja : traduction, poésie et espoir

Kim Hyunja, née à Séoul, est titulaire d’un doctorat de l’université de Clermont-Ferrand sur Jules Supervielle et d’un DEA sur la littérature coréenne de l’époque Koryo à Paris VII. Après l'avoir rencontrée à l'occasion de la venue Jin Eun-young à la librairie, Kim Hyunja a gentiment accepté de répondre à quelques questions que voici.
1. Pouvez-vous nous parler de vos premiers souvenirs de poésie ?
À y réfléchir, mes premiers souvenirs de poésie remontent à mon adolescence, lorsque j’étais collégienne. Ils coïncident littéralement avec mes premiers émois sentimentaux. Sur des petits bouts de papier que me tendait un garçon, je découvrais des poèmes de Yu Chi-whan, comme Nostalgie (그리움), ou de Kim So-wol, tel Appel de l’âme (초혼), des poésies d’amour empreintes d’un certain pathos.
2. Comment avez-vous découvert la poésie française et quelle œuvre poétique vous a interpellée en particulier ?
Même lorsque j’étais collégienne, il m’arrivait déjà de lire, en traduction, de la poésie française dans des anthologies où figuraient souvent des poèmes de Remy de Gourmont — « Simone, aimes-tu le bruit des pas sur les feuilles mortes ? » — ou encore de Verlaine — le fameux « Les sanglots longs des violons de l’automne… ». Plus tard, à l’université, j’ai pu découvrir dans les manuels de français, cette fois dans la langue originale, des poèmes de Prévert ou bien à nouveau Verlaine avec « Il pleure dans mon cœur ».
Lorsque j’ai poursuivi mes études en France, j’ai rencontré l’œuvre de Robert Desnos. Sa vie intime, si émouvante, et ses poèmes, notamment ceux du recueil Corps et biens, m’avaient profondément marquée à l’époque. Parmi mes poètes préférés, je voudrais également citer, entre tant d’autres, Franck Venaille (La Descente de l’Escaut), Philippe Jaccottet et Jules Supervielle.
3. Peut-on dire que c'est la poésie qui vous a amenée à la langue française et non l'inverse ?
Si j’ai étudié le poète Jules Supervielle en France, ce fut en réalité le fruit d’un hasard : le professeur Paul Viallaneix m’avait proposé de consacrer ma thèse à cet auteur. Il préparait alors l’édition des œuvres complètes de Supervielle dans la Bibliothèque de la Pléiade. Au début des années 1980, quelques grands poètes français étaient déjà connus en Corée grâce aux traductions réalisées par des professeurs de littérature française formés en France. On y retrouvait notamment Baudelaire, Valéry et Éluard.
4. Avez-vous trouvé quelque chose dans la poésie française que vous n'aviez pas lu dans la poésie coréenne ?
Oui, bien sûr. La poésie étant affaire de musicalité, de forme et de jeux de langage, j’ai toujours éprouvé une certaine difficulté à pénétrer pleinement dans la poésie française. Cela tient sans doute au fait que la Corée n’étant pas un pays francophone, l’accès à cette langue ne se fait pas naturellement. La poésie coréenne classique, souvent narrative, touche le lecteur par une émotion immédiate et un lyrisme de l’expression ou de la confession. La poésie française, en revanche, apporte une autre dimension : une recherche plus intellectuelle, parfois abstraite, où la musicalité se conjugue avec une densité de pensée. Ainsi, si Mallarmé, Valéry ou Saint-John Perse peuvent sembler hermétiques à un lecteur coréen, leur exigence formelle et leur profondeur conceptuelle ouvrent aussi des horizons nouveaux, complémentaires à ceux de la tradition coréenne.
5. Vous êtes donc traductrice, qu'elle est votre définition de la traduction ?
À votre question, je préférerais parler de mon expérience concrète de la traduction. Depuis que Jean-René Ladmiral, éminent traductologue, a mis en lumière les positions antinomiques du sourcier et du cibliste, les traducteurs sont invités à réfléchir à leur propre approche du texte. Pour ma part, ce dilemme se pose avec encore plus d’acuité puisque je traduis de la poésie. Si je devais énoncer quelques principes, je dirais que j’essaie avant tout de faire entendre la voix du poète, son souffle, de me mettre entièrement à son service, à l’instar de Philippe Jaccottet, grand poète et traducteur. La connaissance intime de l’œuvre originale, dans un souci de fidélité à la lettre autant qu’à l’esprit, m’importe profondément. Bien sûr, il faut aussi offrir au lecteur une version lisible, claire, qui garde sa musicalité.
Mais je me méfie des surinterprétations. Je n’essaie pas d’élever artificiellement le niveau de langage ni de trahir la simplicité lorsque celle-ci est essentielle. Pour les lecteurs qui s’intéressent à la traduction poétique, je conseillerais deux très beaux livres : Patrick Quillier, Le Gardeur de troupeaux de Fernando Pessoa (Gallimard, coll. « Foliothèque », 2009) et Eliot Weinberger, 19 manières de regarder Wang Wei (Éditions Ypsilon, 2020).
6. Quand avez-vous commencé à traduire et avez-vous toujours voulu traduire de la poésie ?
J’ai un ami traducteur prolifique, Thierry Gillyboeuf, qui m’a, il y a une vingtaine d’années, mise en relation avec Claude Michel Cluny, alors responsable de la collection Orphée aux éditions La Différence. Cet éditeur et poète (aujourd’hui disparu) m’a demandé si je souhaiterais traduire Hwang Tong-gyu, un poète qu’il avait rencontré lors d’un voyage en Corée. J’ai accepté cette proposition avec un grand enthousiasme. Ayant écrit une thèse sur Jules Supervielle, traduire de la poésie m’était déjà assez naturel. La traduction des poèmes de Hwang Tong-gyu a finalement été publiée aux éditions Circé en 2000. Depuis, je n’ai traduit que des poètes.
7. Vous traduisez de la poésie coréenne vers le français. Vous arrive-t-il de traduire de la poésie française vers le coréen ?
Oui, il m’est arrivé de présenter Jules Supervielle dans un dossier que la revue Hyundae Munhak (Littérature contemporaine) consacrait aux poètes du monde entier. À cette occasion, j’ai également traduit certains de ses poèmes. Il m’arrive aussi de traduire en coréen des poèmes qui m’ont particulièrement touchée et de les partager avec mes amis poètes coréens.
8. Quelles sont les difficultés que vous traversez dans votre expérience de traductrice ?
Je traduis la poésie coréenne vers le français qui n’est pas ma langue maternelle. Or, plus que tout autre genre littéraire, la poésie résiste à la traduction. Même avec une maîtrise intime de la langue cible, je ne peux jamais mener ce travail entièrement seule. Je sollicite donc l’aide de poètes ou de traducteurs pour atténuer l’empreinte trop marquée de la langue source et affiner mes versions, de façon à les rendre aussi fluides et limpides que possible. Cependant, la relecture, au même titre que la traduction, exige à la fois rigueur et effacement. Je considère que mon travail repose sur un va-et-vient attentif entre les deux langues, qui deviennent mutuellement source l’une pour l’autre. Mais trouver un collaborateur capable de répondre à ces exigences n’est pas toujours chose facile.
9. Vous avez traduit plusieurs recueils et une anthologie aux éditions Bruno Doucey. En général, comment sélectionne-t-on les textes intéressants à traduire ?
Pour l’anthologie Onze poètes coréens de notre temps, C’est l’heure où le monde s’agrandit, j’ai privilégié les poèmes susceptibles d’entrer en résonance avec la ligne éditoriale de Bruno Doucey : une poésie lyrique, une écriture moderne, un regard ouvert sur le monde. La traductibilité et la lisibilité ont également fait partie des critères de choix. Parmi les jeunes poètes, certains privilégient le travail sur la matière même des mots : création lexicale, jeux sur la polysémie. Ce type d’écriture rend la traduction particulièrement difficile, parfois même impossible. Lorsque je sélectionne des poèmes à traduire, j’évite donc ceux qui perdraient tout leur sens sur le plan linguistique lors du passage en français.
10. Pouvez-vous nous parler d'un ou d'une poétesse dont vous appréciez particulièrement le travail ?
Je souhaiterais évoquer Jin Eun-young, poétesse et philosophe que vous avez reçue dans votre librairie l’année dernière. Elle est l’une des voix les plus remarquées de sa génération et une autrice reconnue. En France, ses poèmes ont été traduits par mes soins dans le recueil Des flocons de neige rouge et dans l’anthologie C’est l’heure où le monde s’agrandit, tous deux publiés aux éditions Bruno Doucey.
Lorsque j’ai découvert ses poèmes pour la première fois, j’ai été frappée par l’évidence d’une voix singulière. Dans un texte intitulé « La littérature et l’amitié », publié dans la revue Po&sie (numéro Corée, 2012), elle écrit : « Ce qui m’importe davantage aujourd’hui, c’est de provoquer des sensations qui diffèrent largement de celles dont nous avons l’habitude. » Sa poésie privilégie donc l’expérience de nouvelles sensations, une véritable grammaire des sens, plutôt que la simple transmission d’une signification. Nourrie à la fois de poésie et de philosophie européennes, elle nous livre ses propres interrogations chargées de réflexions profondes et de références culturelles et historiques.
11. Travaillez-vous déjà sur de nouvelles traductions ?
Je viens d’achever la traduction du dernier recueil de Ra Hee-duk, que j’ai provisoirement intitulé Celle qui croit dans les possibles. Je suis actuellement à la recherche d’un éditeur pour ce livre.
J’aimerais également traduire le recueil de poèmes de Sim Bo-seon, paru en 2025 et intitulé L’histoire que tu songeais à écrire au printemps. Dans ses poèmes se mêlent l’acuité du regard sociologique et l’écoute profonde du poète. J’ai déjà traduit certains de ses textes, publiés dans le numéro 139-140 de Po&sie (Belin, 2012), ainsi que dans C’est l’heure où le monde s’agrandit (Bruno Doucey, 2021).
12. Parlons un peu de la poésie en Corée, si vous voulez bien. Dans le panorama littéraire global, quelle place occupe-t-elle ?
En Corée, la poésie occupe une place singulière dans le paysage littéraire. Elle demeure très accessible et largement appréciée par un public diversifié. On peut même dire que la Corée est un des pays au monde où la poésie compte le plus grand nombre de lecteurs. Selon certaines statistiques officielles, le nombre de poètes dépasserait les 10 000, et il existe des dizaines de revues spécialisées.
Le webzine géré par le Conseil des arts de Corée propose chaque semaine divers contenus en ligne, avec une rubrique spéciale « livraison de poèmes ». Par ailleurs, de nombreux amateurs partagent leurs textes favoris sur des blogs, des applications dédiées à la lecture de poésie ou encore sur Facebook.
Le niveau des lecteurs est relativement élevé, et, parmi les jeunes générations, les recueils de poésie expérimentale et au ton contemporain connaissent davantage de succès que les recueils destinés au grand public. Quant aux poètes reconnus, chacun de leurs nouveaux recueils se vend généralement à plus de 10 000 exemplaires.
13. Comme vous le dîtes si bien, la poésie est activement consommée par les lecteurs. Au contraire de la France, où la poésie me paraît réservée à un lectorat plus restreint. Comment la poésie est-elle vue par le lectorat coréen ? Et de quel type de lecteur est constitué ce lectorat ?
En Corée, la poésie demeure un genre populaire et vivant. Beaucoup de poètes font leurs débuts en obtenant un prix lors des concours du Nouvel An organisés par les grands journaux du pays. Des dizaines de revues spécialisées publient régulièrement des textes d’auteurs plus ou moins connus et attribuent de nombreux prix, contribuant ainsi à dynamiser l’activité poétique. Les recueils de poésie figurent même parmi les meilleures ventes en librairie : on se souvient notamment de l’immense succès de poètes tels que Shin Kyeong-nim, Hwang Ji-U ou Do Jong-whan.
En France, la poésie contemporaine est souvent perçue comme un genre accusé d’hermétisme élitiste ou de cérébralité ennuyeuse, tandis qu’en Corée, elle touche un public beaucoup plus large. Le lectorat est en effet très diversifié : on y trouve des amateurs de poésie lyrique classique, les participants aux innombrables ateliers d’écriture (souvent de jeunes femmes), les lecteurs de poésie traditionnelle — notamment le sijo — ainsi que les adeptes de nouvelles formes d’expression poétique, comme le Dicapoem (Dica시 詩), apparu à l’ère du numérique.
14. Comment a évolué la poésie coréenne au fil de l'histoire mouvementée de la Corée moderne ? A-t-elle joué un rôle dans les bouleversements qu'ont connu le pays ? Comment a-t-elle accompagné les différentes tragédies qui ont secoué la Corée (colonisation japonaise, puis guerre de Corée, séparation, dictatures) ?
La poésie coréenne est intimement liée au destin de tout un peuple, marqué par les bouleversements historiques particulièrement dramatiques du XXᵉ siècle. Sous le joug japonais (1910-1945), des poètes tels que Han Yong-un, Yi Sang-hwa, Yi Yuk-sa ou Yun Dong-ju s’engagent activement dans le mouvement de résistance. Ils prennent la plume pour exprimer leur refus de l’assimilation forcée, faisant de la poésie un refuge et un bastion de l’identité nationale.
Après la guerre de Corée (1950-1953), la poésie devient le lieu d’expression d’un traumatisme collectif : séparation des familles, horreur des combats, paysages dévastés, perte des repères. Certains poètes, tels Kim Su-young, Kim Chun-su ou Kim Jong-sam, traduisent cette douleur existentielle tout en explorant, par leurs vers, les élans d’une passion intellectuelle et spirituelle.
À partir des années 1960, la dure réalité sociale de l’industrialisation et de l’urbanisation est interprétée de manière diversifiée par de nombreux poètes, parmi lesquels Shin Kyeong-nim, Kim Ji-ja, Mah Chong-gi, Chong Hyon-jong ou Hwang Tong-gyu.
Sous la dictature, la poésie se fait instrument de lutte démocratique. Dans un contexte de censure, s’épanouit une poésie engagée, la minjung si (« poésie du peuple »), qui accompagne les luttes ouvrières et étudiantes et donne voix à l’aspiration collective à la liberté.
15. Comment l'entrée dans la mondialisation et le développement économique majeur qu'a traversé la Corée à partir du début des années 2000 ont-ils influencé la poésie ?
Depuis le début des années 2000, la mondialisation et le développement économique accéléré de la Corée ont profondément transformé la poésie. On observe d’abord un renforcement de la sensibilité urbaine dans les textes : ordinateurs, smartphones et même métro et autres éléments du quotidien moderne deviennent des motifs poétiques récurrents. En parallèle, les effets négatifs du capitalisme – inégalités sociales, individualisme, sentiment d’aliénation – nourrissent une poésie marquée par l’isolement et l’incertitude.
Sur le plan formel, les schémas poétiques traditionnels sont de plus en plus remis en question, donnant naissance à une création poétique à la fois critique, diversifiée et résolument contemporaine. Les jeunes poètes dits « futuristes » (미래파), apparus au tournant des années 2000, explorent la matérialité des mots et de nouvelles esthétiques.
La poésie coréenne s’ouvre également à des influences multiculturelles et à une sensibilité écologique croissante. Nombre de poètes intègrent désormais des réflexions sur la mondialisation, la diversité culturelle ou encore les enjeux environnementaux, ce qui contribue à élargir et diversifier le champ poétique.
Enfin, l’essor du numérique a favorisé l’émergence du « Dica-si디카시» [poème-photo numérique]. Cette forme hybride, qui associe une simple photographie du quotidien à un court texte poétique, s’inscrit pleinement dans l’ère digitale. Elle illustre la capacité de la poésie coréenne contemporaine à s’adapter aux nouveaux modes de communication et à inventer des formats accessibles à un large public.
16. Pensez-vous que les nouvelles technologies et le développement rapide de l'intelligence artificielle seront un danger pour la poésie dans le futur ? Comment l'IA peut-elle modifier la manière d’écrire de la poésie ? Je pense notamment à la publication en 2022 d'une anthologie de poèmes entièrement écrits par une IA, qui avait déclenché de nombreuses discussions.
En 2022, la publication de La raison pour laquelle j’écris des poèmes, premier recueil écrit intégralement par l’IA dénommée SIA (signifiant l’enfant qui écrit de la poésie), a effectivement suscité de vifs débats. Cet « auteur numérique », entraîné sur plus de 13 000 poèmes et utilisant le modèle KoGPT, était capable de produire un texte en trente secondes. Or, cette rapidité met en lumière un paradoxe : si l’IA maîtrise les structures, les images et la musicalité des mots, elle demeure étrangère à la souffrance, à l’expérience vécue et au travail intérieur qui sont au cœur de la poésie humaine. Je songe à ce vers de Mallarmé « la clarté déserte de ma lampe sur le vide papier que la blancheur défend » ou de celui de Hwang Tong-gyu « Oh ! la nuit blanche durant laquelle la langue de l’être humain est devenue toute tannée ». Le danger réside justement dans cette absence de chair et de souffle vital.
Cependant, certains y voient un outil d’expérimentation, capable de générer des bases textuelles claires que l’auteur peut ensuite retravailler, enrichir de sa voix, de son imaginaire et de sa sensibilité. Dans ce contexte, l’IA ne se substituerait pas au poète, mais lui ouvrirait de nouvelles perspectives, comme un « collaborateur créatif ». Pour ma part, je souhaite vivement que les poètes humains pourront toujours préserver ce qui fait l’essence de la poésie : l’expression singulière d’une expérience vécue et d’un souffle intérieur.
17. Existe-t-il de nos jours plusieurs courants poétiques en Corée ?
Aujourd’hui, le paysage poétique coréen se distingue par sa grande diversité et son dynamisme, reflet d’un lectorat varié et exigeant. Plusieurs courants s’y côtoient, entre tradition et modernité. À côté de la poésie lyrique classique s’inscrit le sijo, forme traditionnelle coréenne que les poètes contemporains renouvellent en adaptant sa sensibilité à notre temps, tout en demeurant fidèles à son cadre formel. La poésie engagée, héritière des luttes démocratiques des années 1980, continue de dénoncer les injustices sociales, la précarité et les inégalités.
La poésie féministe connaît également un essor marqué, portée par de nombreuses voix féminines. Expérimentale et revendicative, elle remet en question le patriarcat, les normes sociales et explore de nouvelles esthétiques, parfois en rupture totale avec le passé.
Par ailleurs, les jeunes poètes dits « futuristes » (미래파), apparus dans les années 2000, privilégient l’expérimentation linguistique et la recherche formelle, explorant des voies radicalement innovantes. Enfin, à l’ère digitale, la poésie s’invite sur les réseaux sociaux et dans de nouveaux formats comme le Dicapoem (디카시), qui associe image et texte bref.
18. Quelles sont les thèmes récurrents de la poésie contemporaine en Corée ?
En préparant l’anthologie C’est l’heure où le monde s’agrandit, il m’a semblé que les voix des onze poètes traduits dessinaient ensemble un paysage riche et cohérent de la poésie coréenne d’aujourd’hui. Chacun d’eux possède son univers propre, mais de leurs textes surgissent des préoccupations communes qui révèlent les grands axes de la création poétique contemporaine.
La poésie qui s’interroge elle-même
Ce qui frappe d’abord, c’est que tous, à leur manière, questionnent le geste d’écrire. La poésie n’est pas pour eux un simple miroir du monde, mais une interrogation constante : que peut le poème ? Comment dire l’indicible ? Ce doute fertile devient le cœur battant de leur création.
L’amour, toujours
De l’élan passionné à la tendresse discrète, de l’attachement filial à la douleur de la séparation, l’amour circule dans ces poèmes comme une énergie universelle. Chez chacun, il prend une couleur différente, mais reste le fil qui relie les êtres et les ouvre à l’altérité.
Le regard tourné vers les autres
Beaucoup de poètes – Kim Sun-woo, Lee Young-kwang, Lee Byung-ryul, Moon Tae-joon ou Park Joon – se tournent vers celles et ceux qu’on ne voit pas. Les gens en marge, les solitaires, les oubliés. Leur poésie est traversée d’une profonde empathie : écrire devient alors un acte d’hospitalité.
La quête de soi et les voyages
Chez An Heon-mi, Kwak Hyo-hwan, Jin Eun-young ou Shim Bo-seon, le voyage, qu’il soit géographique ou intérieur, devient une métaphore de la recherche de soi. Errances, déplacements, inquiétudes spirituelles : le chemin est moins un lieu que l’expérience d’une quête.
La famille, lieu d’amour et de fractures
La famille revient comme un motif lancinant. Il y a l’amour filial chez Moon Tae-joon ou Park Joon, l’amour maternel dans les poèmes de Jeong Keut-byul ou An Heon-mi. Mais aussi des rapports plus tendus, plus conflictuels, comme chez Jin Eun-young. La famille, ici, est à la fois refuge et épreuve.
La nature, un espace de communion
Le paysage, la montagne, l’arbre ou la pluie ne sont pas de simples décors. Dans les poèmes de Moon Tae-joon ou Kwak Hyo-hwan, la nature se fait partenaire agissante, présence humble et fraternelle. Le sujet lyrique s’y efface parfois, comme pour mieux rappeler que nous faisons partie d’un ensemble plus vaste que nous.
Le temps, fil invisible
Certains poètes, comme An Heon-mi, méditent sans relâche sur le passage du temps. Chez Park Joon, il devient même une ossature poétique, une architecture invisible qui soutient le poème et le rythme.
La spiritualité bouddhique
Le bouddhisme, profondément ancré dans la culture coréenne, irrigue aussi cette poésie. Moon Tae-joon, Kim Sun-woo ou Lee Byung-ryul en font entendre les échos : compassion, impermanence, quête d’éveil. La sagesse spirituelle se mêle alors à l’expérience intime du monde.
Le deuil et la mémoire des disparus
Enfin, il y a la douleur de la perte. Les poèmes de You Hee-kyoung marqués par la disparition du père, ceux de Jin Eun-young après la mort d’un petit neveu, ou encore l’hommage de Kim Sun-woo aux victimes du naufrage du Sewol survenu en 2014 rappellent combien la poésie demeure un lieu de mémoire et de consolation.
19. Pour terminer sur une belle note, si je vous dis "espoir", y a-t-il un poème, un texte qui vous vient à l'esprit ?
Pour clore sur une note d’espérance, si vous me dites « espoir », c’est un poème qui s’impose aussitôt à moi. En ces temps de transition que traverse la Corée, Le printemps de Lee Sung-boo prend une résonance singulière. Écrit dans les années 1970, il portait le vœu ardent de voir éclore la démocratie et la liberté. On y entend cette promesse douce et tenace : « Lentement, lentement, ce qui devait arriver finit toujours par arriver […] Je te serre contre mon cœur, en ouvrant mes bras avec peine / ô toi qui es revenu de loin après avoir vaincu ! »
Un immense merci à Kim Hyunja d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, et pour l'amour pour la poésie qu'elle nous transmet avec bienveillance et générosité.