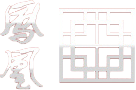François Jullien

l' « écart » comme méthode
François Jullien, philosophe et sinologue
contemporain, se distingue principalement par l'usage méthodologique qu'il
propose de faire de la pensée chinoise. Son geste fondamental consiste en
effet à se familiariser avec la langue chinoise en vue de réfléchir sa propre
pensée, c'est-à-dire la philosophie (européenne). C'est dans cet
« écart » qu'il devient possible de prendre conscience de l'impensé
de notre pensée, de ce dont on préjuge, c'est-à-dire de ce à partir de quoi
l'on pense et que par là-même nous ne pensons pas. C'est grâce à ce détour par
la Chine, par cet ailleurs, que l'auto-réfléchissement est réalisable et que
l'on parvient à être capable d'évaluer les ressources et les impasses,
théoriques ou pratiques, de ces deux formes de pensée.
Les premiers ouvrages de Jullien sont autant
de tentatives d'affleurement de la
pensée chinoise dans ses différents domaines de déploiement. Ils témoignent
d'un véritable effort de conceptualisation dans le but de saisir cette nouvelle
cohérence intellectuelle. Jullien, en tant que philosophe, crée en effet des
concepts en vue d'unifier les divers usages d'un même terme chinois, révélant
ainsi, au lecteur occidental, qu'à la langue chinoise correspond une autre
manière de s'approprier le réel. Par exemple, notre auteur forge le concept de
« propension » dans La
propension des choses, soulignant ainsi ce qu'il y a de commun au sein des
différents usages du mot chinois « shi » 势.
Ce dernier dépasse la dichotomie occidentale état / mouvement des
choses. Le chinois permet ainsi de penser dans un même temps la dynamique,
la puissance au sein même de la disposition.
Chemins
faisant, connaître la Chine, relancer la philosophie qui est une réplique aux
objections du sinologue Jean-François Billeter, apparaît avant tout comme une
respiration, une pause dans l'œuvre de François Jullien. Dans ce livre, Jullien
rend compte du chemin qu'il a jusqu'ici parcouru et explicite très clairement
sa « méthode » de travail. C'est à l'occasion de cette réplique,
qu'il prend le temps de faire le point sur sa façon de concevoir la Chine (qui
ne constitue pas une altérité radicale), sur sa manière de traduire le texte
chinois (qui ne consiste pas à revenir à du familier) et de produire des
concepts (qui ne se résume pas à maintenir une traduction unique et arrêtée).
Cet ouvrage constitue peut-être la plus accessible introduction au travail de
Jullien.
Une
controverse s'est ouverte il y a trois ans entre deux sinologues français,
François Jullien et Jean François Billeter, à l'occasion de la parution d'un
petit ouvrage de ce dernier intitulé Contre François Jullien. Le
problème qui est mis en jeu concerne la méthode que doit suivre le sinologue
lorsque celui-ci envisage les textes chinois. Plus précisément, c'est la
question de la traduction qui est ici au centre de la polémique. Qu'est-ce
qu'une bonne traduction, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une traduction qui trahit le
moins le sens du texte original ?
Nos deux sinologues soutiennent des thèses contraires. Alors que Billeter pose d'emblée une unité foncière de l'expérience humaine qui lui permet d'envisager la traduction comme aisée et naturelle ayant pour fonction de revenir à du familier, Jullien considère la traduction comme un effort sans cesse repris et jamais pleinement récompensé à ébaucher une possibilité de pensée jusqu'alors étrangère. Alors que l'un comprend la traduction comme une opération de « rapprochement », l'autre la pense comme un « écart », un « déplacement ». Pour rentrer plus en détail dans la pensée de ses deux auteurs, il serait intéressant d'user du texte de Gadamer sur la méthode herméneutique (du fascicule) comme d'un outil pour distinguer ces deux positions qui s'opposent. Dans ce texte Gadamer propose une méthode de traduction qui peut en effet nous éclairer.
Le premier point qui doit retenir notre attention concerne le rapport qu'un lecteur doit avoir avec un texte qui n'est pas rédigé dans la langue qu'il connaît par sa littérature ou sa pratique commune. Bien sûr, sur cette question Billeter et Jullien ne sont pas du même avis et c'est d'ailleurs en raison de ce désaccord foncier que leurs méthodes de traduction divergent radicalement. Reprochant à Jullien de poser une altérité de principe concernant la Chine, Billeter suppose un socle commun, une manière commune de concevoir et d'appréhender les choses qu'auraient en partage l'occident et l'orient. C'est pour cette raison qu'il reproche à beaucoup de sinologues de poser « "a priori" que la pensée chinoise est différente de la nôtre » (J.-F. Billeter) et qu'il ne pense pas que les notions chinoises aient une richesse de sens particulière. La conception que Jullien a, lui, de la Chine n'est pas celle de Billeter mais elle n'est pas non plus celle que son objecteur lui attribue. Jullien ne pose pas d'altérité de principe. La Chine n'est pas « autre », elle n'est pas opposée, elle n'est pas le contraire de l'Europe, car cela impliquerait un cadre de référence initial qui permettrait de juger de l'altérité. Jullien préfère le concept de Foucault d' « hétérotopie » pour caractériser la Chine. La Chine est un « ailleurs » (F. Jullien), qui, en raison du fait qu'elle s'est développée pendant des siècles à l'écart, n'est pas différente mais indifférente à l'occident. Il y a chez Jullien cette idée heideggerienne, que l'on retrouve chez Gadamer, d'une historicité de l'Etre qui est redoublée par une géographie (ou « géographicité ») de l'Etre. Il n'y a pas de socle notionnel commun et initial entre l'Europe et la Chine. Cette dernière connaît une aventure de la pensée indépendante de la nôtre.
C'est en raison de cette divergence de conception que Billeter et Jullien n'abordent pas la traduction selon la même méthode. Selon Billeter, la traduction consiste, comme nous l'avons dit précédemment, dans une opération de « rapprochement » qui permet de rendre le passage d'une langue à l'autre naturel, avec cette conséquence que le texte original apparaît, en définitive, « moins chinois et nous (rappelle) ce que nos auteurs nous ont aussi dit » (J.-F. Billeter). Une telle traduction suppose qu'en règle générale ce qui nous est dit dans un texte étranger s'insère sans rupture dans les pensées et les attentes qui nous sont propres. Le procédé de traduction que valorise Billeter réside dans le fait qu'il faut rendre par une phrase française simple et claire une phrase chinoise qui est, elle-même, dés le premier abord simple et claire. Il y a en chinois et en français des notions abstraites qui en elles-mêmes n'ont pas de signification précise. Ce n'est que dans leur rapport aux autres termes de la phrase que ces notions prennent un sens déterminé. De telle sorte que des notions chinoises prises indépendamment de tous contextes peuvent apparaître tant éloignées de notre jargon commun. Mais ce n'est qu'illusion car dés que ces termes sont mis en liaison les uns avec les autres, une signification commune se fait jour. Pour illustrer cette idée, on peut se référer à des exemples de traduction (de la notion de tao) de Billeter, ce dernier choisissant rarement de garder une notion chinoise dans une traduction unique et préférant faire varier la traduction selon le contexte de la phrase pour rendre le texte aisément intelligible en français. C'est ainsi qu'il rend la traduction littérale de « Si un matin j'entends le tao, je puis mourir le soir. » par « Si un matin j'apercevais enfin le fond des choses, je pourrais mourir le soir.», ou encore « As-tu un tao de la nage ? » par « As-tu une technique de la nage ? », ou enfin « Le tao doit avoir un but précis, sinon il se divise, il se brouille, il tourne mal et cause à la fin des dégâts irréparables. » par « L'action doit avoir un but précis, sinon elle se divise, elle se brouille, elle tourne mal et cause à la fin des dégâts irréparables. ». Billeter remplace le chinois par de l'occidental.
La conception qu'a Jullien de la traduction est totalement opposée à cette première. La traduction ne doit pas plaquer sur le texte chinois les catégories de pensée occidentales, elle ne doit pas présupposer une entente a priori. En ce sens, Jullien comprend la traduction dans un sens très proche de l'herméneutique. « L'interprétation a pour tâche première, permanente et dernière de ne pas se laisser imposer ses acquis, de même que ses anticipations de vue et de saisie, par des intuitions et notions populaires » (Gadamer). Pour Jullien en effet, la pensée européenne et la pensée chinoise ne se sont pas construites sur les mêmes socles notionnels. Parce que la civilisation chinoise et la civilisation européenne se sont développées à l'écart l'une de l'autre, historiquement et géographiquement, leurs « ce à partir de quoi elles pensent » (F. Jullien) ne coïncident pas. Jullien parle de « pré-notionné » ou de « pré-catégorisé » ou encore de « pré-questionné » qui renvoie à la même chose que le « préjugé » de Gadamer. D'ailleurs, il souligne le caractère non exclusivement péjoratif du préjugé lorsqu'il écrit que son travail ne consiste « pas tant, (…), de s'affranchir du préjugé, au stade donc de ce qui détermine le jugement (vrai ou faux, bien ou mal), comme l'entreprend si frontalement Descartes par un doute offensif ; mais tenter d'avoir prise en amont de lui, à un stade que n'envisageait pas et même ne soupçonnait pas Descartes » (F. Jullien), au niveau du « pré-notionné ». La traduction doit donc témoigner d'une prise de conscience de nos propres préjugés et tenter d'affleurer les préjugés chinois. « Ce qui est requis, c'est uniquement l'ouverture à l'opinion (…) du texte. (…) Qui veut comprendre un texte refuse de s'en remettre au hasard de sa pré-opinion propre, qui le rendrait sourd, avec la cohérence et l'obstination la plus extrême, à l'opinion du texte » (Gadamer). La critique qui est sous-entendue dans cette dernière phrase de Gadamer est exactement celle que Jullien fait à Billeter dans sa Réplique. Jullien écrit « mon contradicteur projette ainsi systématiquement –d'une façon ingénue apparemment- des catégories occidentales dont il ne semble pas soupçonner comme elles le font dévier ». Pour preuve, Jullien se réfère aux traductions précédentes de Billeter qui ont pour notion commune le tao et éclaire leurs abus. Billeter gonfle ses traductions de l'ontologie occidentale (lorsqu'il traduit par exemple tao par fond des choses). Même lorsqu'il croit donner une traduction littérale, il est déjà en train de remplacer les notions chinoises par des notions occidentales. Quand il écrit « le tao doit avoir un but précis », Jullien signale qu'il importe la notion de but, qui n'est pas dans le texte chinois, « pour rendre sa traduction plus coulante. (…) Du même coup il nous fait basculer d'emblée dans la pensée finaliste, « téléologique », qui nous est familière (le « telos » des Grecs) ». Or la traduction doit s'appliquer à prendre conscience de ses propres anticipations et tenter de s'en distancer tout en se rapprochant du texte même.
Le procédé de traduction que favorise Jullien est alors un processus illimité. Dans la mesure où la distance temporelle et géographique est telle qu'il y a entre l'auteur et l'interprète une différence insurmontable, la traduction est un mouvement toujours repris, jamais fini qui met en suspension nos préjugés à mesure qu'ils apparaissent. C'est pour cette raison que Jullien comprend « sa traduction proposée que comme un moment -d'affleurement- du procés de traduction considéré dans son entier, (il) commente toujours, et critique, la traduction (qu'il) propose, pour rattraper et corriger ce qu'elle a laissé perdre du texte originel : (il) rouvre ainsi le champs des possibles compris par le texte de départ et que (sa) traduction , tranchant en lui, a abusivement réduit ». Sa traduction étant en français, elle passe immanquablement à côté du texte même, mais étant en même temps une prise de conscience de ses présupposés elle témoigne d'une véritable production de la compréhension. Jullien use de termes français en les réinvestissant d'une nouvelle épaisseur. Tel en est le cas pour le concept de propension qui tente de rendre une caractéristique de la pensée chinoise de l'inséparation du statique et du dynamique. Ainsi, comme il l'objecte lui-même à Billeter, Jullien ne pose pas une altérité de principe, il la construit maille après maille. Ce procédé semble illustrer assez bien le cercle herméneutique heideggerien, « la compréhension du texte reste déterminée en permanence par le mouvement d'anticipation de la précompréhension » (Gadamer). Et elle est avant tout productive.