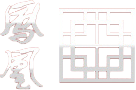La chambre jaune

Le regard que porte aujourd'hui la Chine sur le sexe n'est plus le même que celui d'hier. Les anciens Chinois n'ont jamais vraiment intégré la sexualité à leur discours éthique, et sans doute est-ce à cette absence de toute moralisation du sexe que l'on doit la grande liberté sexuelle qu'a connue la Chine ancienne et impériale. Cette grande liberté reste bien entendu relative.
Elle fut notamment balisée en fonction des dynasties et des règnes plus ou moins austères d'empereurs plus ou moins chinois ainsi que de la confession de chacun d'eux (confucéenne, bouddhiste ou taoïste. Elle fut enfin balisée par bons nombres d'interdits dont les raisons sont à trouver dans les conceptions proprement chinoises du monde et de l'homme. La moralisation du sexe et de la vie sexuelle semble chose récente en Chine et paraît résulter d'une double influence de l'extérieur. Tout d'abord de celle des Mandchous, qui gouvernèrent la Chine entre le XVIIe et le XIXe siècle (dynastie Qing), et enfin de celle des Européens, moyennant ces porteurs de la morale chrétienne présents en Chine dès le XVIe siècle que furent les Jésuites et les Missionnaires d'une part, et moyennant d'autre part notre contagieux puritanisme pudibond de ces derniers siècles dont se sont imprégnés les Chinois alors que ceux-ci s'employaient à imiter les modèles économiques, sociaux, politiques et donc moraux, de l'Europe.
De fait, pensées politique et morale européennes ont conjointement influencé l'esprit chinois et orienté sont rapport actuel au sexe. En bref, il est toujours amusant d'entendre aujourd'hui certains Chinois s'insurger du « dévoiement moral des Occidentaux » en matière de sexualité, cette idée même de « dévoiement moral », dans ce domaine, étant totalement étrangère à l'esprit des anciens Chinois et ayant précisément été introduite par les Occidentaux en Chine il y a peu. Aujourd'hui soucieuse de contrôler son image à l'international, notamment au plan moral et politique, la Chine continue d'essayer de (faire) taire et/ou de réécrire certains aspects de son histoire sociale, de sa littérature et de ses arts, sur des sujets dont elle n'a finalement que récemment appris à avoir honte et au premier rang desquels figure la sexualité.
L'évolution du rapport des anciens Chinois au sexe est superbement retracée par Robert Van Gulik dans La vie sexuelle dans la Chine ancienne, un livre premièrement destiné à accompagner et introduire l'ouvrage de peintures érotiques de sa collection qu'il s'apprêtait à publier (intitulé Erotic Prints). L'auteur y traite de « sexualité impériale », exposant les rapports des empereurs avec épouses, concubines, favoris ou mignons, depuis l'époque ancienne jusqu'à la chute de l'empire au début du XXe siècle, ainsi que de « sexualité religieuse », abordant les rapports entretenus par confucéens, taoïstes et bouddhistes avec lui, mais encore de « sexualité populaire », quoiqu'au contraire du Roman les documents officiels chinois ne s'arrêtent que peu sur la vie quotidienne du peuple. Ce livre a été traduit en Chine continentale (épuisé) ainsi qu'à Taiwan.
À lire
- VAN GULIK Robert, La vie sexuelle en Chine ancienne, Paris, éd. Gallimard, coll. Tel, 1971.
- VAN GULIK Robert, Erotic Prints of Ming Period (en anglais), Taipei, SMC Publishing, 1951.
- VAN GULIK 高羅佩, Zhongguo yanqing 中國艷情, Taiwan, éd. Fengyun shidai, 1994.
- HU Hongxia 胡宏霞, Da nan nü 大男女, Beijing, éd. Huayi, 2008.
- JIANG Shaoyuan 江晓原, Xing zhangli xia de Zhongguoren 性张力下的中国人, Shanghai, éd. Renmin, 1995.
Aussi, rien de tel qu'une incursion dans le roman Ming (XIVe – XVIIe siècles) pour prendre la mesure de la liberté d'esprit dont jouissait la Chine d'hier, tant dans la pensée que dans le verbe. Parmi les plus grands textes érotiques chinois figure le Jin ping mei, couramment traduit « Fleur en Fiole d'Or ». L'histoire du Jin ping mei développe en plusieurs centaines de pages un épisode du Shui hu zhuan (« Au bord de l'eau ») tenant sur quelques lignes seulement. Ce roman fleuve peint la vie sexuelle agitée d'un Ximen Qing toujours à la recherche de nouvelles conquêtes sans ne jamais tomber dans la pornographie, puisque, entre tiges et flûtes de jade, cithares d'argent et castagnettes d'ivoire, toujours à elle se substituent la poésie et l'analogie.
À lire
- Fleur en Fiole d'Or (coffret 2 vol.), Paris, éd. Gallimard, coll. Folio, 2004.
- Fleur en Fiole d'Or, Paris, éd. Gallimard, coll. Pléiade, 2004. 2 tomes.
- Kinp'ing mei ou la merveilleuse histoire de Hsi Men avec ses six femmes, Paris, éd. Guy le Prat, 1985.
- Jing ping mei 金瓶梅, 2 vol., Singapour, éd. Nanyang, 2006.
- Jing ping mei zidian 金瓶梅字典, Beijing, éd. Jingguan jiaoyu, 1999.
Plus directe, la prose de Li Yu ! celui-là qui même à couvert d'histoires édifiantes ne réussit que mal à échapper à la censure tant ses textes sont osés. Ainsi en va-t-il du Rou pu tuan (traduit « De la chair à l'extase », ou « La chair en tapis de prière »), roman dont le héros, amicalement éclairé sur la relative petitesse de son outils, accepte la greffe d'un pénis canin dans l'espoir d'épater ses conquêtes et d'en décupler le nombre.
À lire
À lire
- LI Yu, De la chair à l'extase, Arles, éd. Picquier, 1994.
- LI Yu, Jeou-p'ou-t'ouan ou la chair comme tapis de prière, s.l., éd. Pauvert, 1962.
- LI Yu 李漁, Rou putuan miben 肉蒲團秘本, Taipei, éd. Guojia, 2009.
- CHEN Yiyuan 陈益源 , Gudian xiaoshuo yu qingse wenxue 古典小說與情色文學, Taipei, éd. Liren, 2001.
La littérature chinoise prend un malin plaisir à mettre en scène moines bouddhistes et autres religieux défroqués en situation d'interdit, souvent à travers blagues et histoires drôles, comme pour dénoncer la stupidité de ces hommes incapables de se priver de ce dont ils sont pourtant censés avoir eux-mêmes décidé de se priver. L'attitude confucéenne est différente : il ne s'agit pas de rejeter le sexe pour lui-même mais bien pour ce qu'il engendre au plan psychologique, savoir le désir et donc l'égoïsme, dont le flot non maîtrisé sape et détruit les fondements de toute construction morale. Le sexe occupe en revanche une place fondamentale dans les traités du taoïsme religieux, et plus spécifiquement dans les textes d'écoles recourant aux techniques sexuelles comme moyen pour la culture de soi ou l'alchimie interne. Parmi les traités traduits en français abordant ces pratiques figure celui de Zhao Bimei, rendu en français par Catherine Despeux sous le titre Traité d'Alchimie et de Physiologie Taoïste. D'autres traités existent ou ont existé, mentionnés pour certains par Van Gulik dans son essai, qui sont consacrés à l'art de la chambre à coucher et abondent en conseils pratiques, tel le Su nü jing.
À lire
À lire
- Moines et nonnes dans l'océan des pêchés, Arles, éd. Picquier, 1999.
- Youxi zhuren 游戏主人, Xiaolin guangji 笑林广记, Jinan, éd. Qilu shushe, 2002.
- ZHAO Bimei, Traité d'Alchimie et de Physiologie Taoïste, Paris, éd. Les deux océans, 1990.
La prostitution, en Chine, est une tradition, une institution. Quoique fortement encadrées, lorsqu'elles ne furent pas interdites comme sous la dernière dynastie des Qing (laquelle est aussi responsable de la pénalisation de l'homosexualité passive), les prostitutions féminine et masculine sont acceptées au point qu'il est aujourd'hui permit de les déclarer indissociables de la vie sociale en Chine ancienne et impériale. Nous possédons de nombreux ouvrages en langue chinoise sur ce sujet dont un choix est présenté en bibliographie. Il en va pareillement de l'homosexualité masculine, omniprésente hier en Chine à tous les degrés de l'échelle sociale (de nombreuses histoires d'amour entre certains empereurs et leurs favoris sont restées célèbres et devenues proverbiales), mais aujourd'hui officiellement muselée par la politique des « trois ne-pas » (san bu zhengce), soit 1. Ne pas soutenir 2. Ne pas encourager 3. Ne pas empêcher… lorsqu'elle n'est pas dans les faits condamnée. Nous possédons différents textes sur l'histoire de l'homosexualité en Chine ancienne et impériale en langue chinoise, la référence en langue anglaise demeurant l'étude de Bret Hinsch, Passion of the Cut Sleeves.
À lire
À lire
Sur la prostitution :
- SHAO Yong 邵雍, Zhongguo jindai jinü shi 中国近代妓女史, Shanghai, éd. Shanghai renmin, 2005.
- YAN Ming 嚴明, Zhongguo ming ji yishu shi 中國名妓藝術史, Taipei, éd. Wenjin, 1992.
- Banqiao zaji 板桥杂记, suivi de Xu Banqiao zaji 续板桥杂记 & Banqiao zaji ju 板桥杂记补, Nanjing, éd. Nanjing, 2006.
Sur l'homosexualité :
- HINSCH Bret, Passions of the Cut Sleeves, s.l., éd. University of California Press, 1992.
- SOMMER Mathew H., Sex, Law and Society in Late Imperial China, s.l., éd. Stanford University Press,2000.
- ZHANG Zaizhou 张在舟, Aimei de licheng : Zhongguo gudai tongxinglian shi 暧昧的历程中国古代同性恋史, Zhengzhou, éd. Zhongzhou guji, 2001.
- SHI Ye 施晔, Zhongguo gudai wenxue zhong de tongxinglian shuxie yanjiu 中国古代文学中的同性恋书写研究, Shanghai, éd. Shanghai renmin, 2008.
- ZHANG Jie 张杰, Quwei kaoju : Zhongguo gudai tongxinglian tukao 趣味考据--中国古代同性恋图考, Kunming, éd. Yunnan & Yunnan renmin, 2008.
La représentation des choses du sexe existe en Chine plus que partout ailleurs : dessiné sur le papier ou taillé dans le jade, peint sur la céramique ou gravé dans le bois, le sexe est partout exprimé. Amours hétéro et homosexuels sont pareillement illustrés, dans une finesse qui tranche avec la vigueur du modèle japonais. De nombreux ouvrages existent sur les arts érotiques chinois et japonais, dont on trouvera un choix ci-dessous.
À lire
À lire
- Rêves de printemps : l'art érotique en Chine, Arles, éd. P. Picquier, 1998.
- Poème de l'oreiller et autres récits : Utamaro, Hokusai, Kuniyoshi et autres artistes du Monde Flottant, Paris, éd. Phaidon, 2010.
- BERTHOLET Ferry M., Concubines et courtisanes, Paris, éd. Imprimerie nationale, 2010.
Par Anthony Diaz