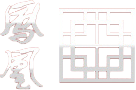La contre-culture japonaise
A la fois force de contestation et force de proposition, la contre-culture prend à revers les normes sociales établies. Dès la fin des années 1950 sont apparues au Japon de nouvelles formes en marge de la culture officielle, à l'initiative de collectifs ou d'individus isolés.
Le Japon d'après-guerre a vu ainsi exploser le nombre de musiciens, performeurs, danseurs, poètes, écrivains, artistes, photographes, réalisateurs attachés à faire émerger de nouvelles formes artistiques dans une visée pour le moins contestataire.
A l'exception de grandes études et/ ou de rétrospectives, il est encore assez rare que soit mis en avant ces œuvres et travaux d'avant-garde restés en toute logique confidentiels. Néanmoins, grâce à l'initiative de plusieurs acteurs du monde culturel ou de chercheurs, il existe désormais un nombre croissant de publications sur le sujet.
Avec cette sélection, nous avons eu envie de partager avec vous des ouvrages portant sur des courants artistiques ou des figures emblématiques de la contre-culture japonaise.
Publication de référence des Presses du réel, Introduction à l'esthétique est la première traduction en français d'un ouvrage de Nakai Masakazu par Michael Lucken, professeur à l'Inalco, historien et japonologue français. Nakai Masakazu est un philosophe et critique japonais de la première moitié du XXe siècle qui fit du politique et de l'artistique le cœur de sa pensée. Ses écrits se révèleront essentiels pour comprendre ce qui se joua au Japon dans les années 1910 à 1950 tout en permettant de saisir avec plus de facilité les mouvements contestataires japonais qui émergeront par la suite dans les années 1960.
Complémentaire, l'ouvrage Nakai Masakazu – Naissance de la théorie critique au Japon, publié quelques années plus tôt par Michael Lucken propose une étude sur le philosophe qui, comme nous le disions, marqua les mouvements de contre-culture des années 1960. A travers cette biographie riche et exigeante Michael Lucken procède à son tour à l'état des lieux de la pensée à l'époque moderne au Japon.
Figure incontournable de la contre-culture japonaise, Kazuki Tomokawa a vécu l'explosion de la scène artistique alternative dans les années 1970 à Tokyo. Musicien, peintre et poète, il publie en japonais en 2015 Try Saying You're Alive ! le récit de son quotidien, dans un genre qui mêle l'autobiographie et la fiction. Le livre sera traduit en anglais quatre ans plus tard. Il nous permet de découvrir le Tokyo alternatif de l'époque, électrisé par les rencontres, les concerts et les évènements en tous genres qui firent l'émergence de la scène underground d'après-guerre.
Autre personnalité hors-norme, le danseur et chorégraphe japonais Hijikata Tatsumi qui vécut dans le japon d'après-guerre et revendiquait sa proximité avec les opposants, les marginaux et les exclus. Créateur de l'ankoku butō (danse des ténèbres), ses créations mettaient en avant un corps meurtri et contraint qui entraient en résonnance avec les oppositions virulentes au régime politique d'alors. Il bouleversa la danse moderne en proposant des créations transgressives en excluant toute notion d'harmonie ou de beauté. Le recueil de texte du philosophe et traducteur Uno Kuniichi propose dans Hijikata Tatsumi – Penser un corps épuisé une analyse philosophique de l'œuvre de ce chorégraphe hors-norme en le rattachant à des figures comme Genet ou Artaud. Cet ouvrage est l'une des rares publications d'un ensemble de textes sur Hijikata rédigé et traduit en français.
Dans Pornologie vs capitalisme – Le groupe de happening Zero Jigen – Japon 1960-1972, Bruno Fernandès fait une étude du collectif, artistes performeurs, contemporain de Hijikata Tatsumi. Dans une veine ritualiste les actions subversives de Zero Jigen empreintes d'une forme d'obscénité, consistaient en des actions collectives qui se déroulaient principalement dans l'espace public . Cet essai est le premier réalisé en français sur le groupe d'avant-garde japonais qui sévit des années 1963 et 1972 au Japon.
En lien avec la scène musicale qui émergea à la fin des années 1970, l'ouvrage Japanoise de Jeremy Corral est un trésor pour ceux qui s'intéresse à la musique électronique et à la musique noise au Japon. Dans son livre, l'auteur fait une étude très précise du genre musical, un genre qui a bénéficié jusque-là de très peu d'analyses critiques en français. Il reconstitue brillamment l'histoire et les pratiques de ce mouvement tout en établissant les liens que le genre musical entretient avec les arts dits contemporains.
Phénomène majeur de l'histoire des avant-gardes et de la contre-culture au Japon depuis la fin des années 1970, la noise a longtemps été associée à une forme de provocation, d'excès et d'incompréhension. Toutefois, ce mouvement musical a exercé une influence particulière sur les scènes de musique underground du monde entier mais a jusque-là bénéficié de très peu d'analyses. Cet ouvrage exigeant et pointu recense comme nul autre la diversité des propositions dans le champ de la musique expérimentales au japon !
Micro Japon est quant à lui une compilation d'interview d'acteurs de la scène expérimentale au Japon réalisée par Michel Henritzi. Musicien, producteur et critique musical, lauréat de la Villa Kujoyama de Kyoto en 2007, Michel Henritzi a collaboré dans les années 1980 avec plusieurs groupes de rock industriel et a fondé le label AKT avec le collectif NOX. Sa grande connaissance en la matière lui permet de révéler la richesse de la scène musicale expérimentale nippone.
Publiée en 1968-1969, la revue Provoke a été la revue la plus caractéristique du renouveau de la photographie au Japon. Elle a permis à des photographes tels que Yutaka Takanashi et Daido Moriyama par exemple, de développer un nouveau langage photographique dont le radicalisme revoyait aux protestations étudiantes qui avaient lieu à l'époque. D'autres, tels que Issei Suda ou Nobuyoshi Araki développeront parallèlement de nouvelles formes propres et singulières qui s'imposeront tout autant.
Pour découvrir le travail de Daido Moriyama, parmi les nombreuses publications du photographe, il existe deux petits ouvrages caractéristiques de sa photographie. Intitulé Daido Moriyama, ce livre propose un ensemble de photographies de rue, instantanées, en noir et blanc et aux contrastes marqués. Brutes, floues, ou encore surexposées, ses images bancales et imparfaites deviendront représentatives de son travail et de l'approche révolutionnaire de certains photographes pour l'époque. Dans I take photographs ce sont à nouveau des photographies de portraits et de lieux, mêlant la couleur le noir et blanc cette fois, prises dans différents quartiers de Tokyo. A nouveau, le style de Daido Moriyama s'impose dans sa radicalité et confirme une nouvelle pratique de la photographie de rue.
Autre photographe qui a su s'imposer avec des images d'une grande singularité, Issei Suda. Egalement connu pour ses tirages en noir et blanc contrastés des rues nippones ou taïwanaises ce dernier évolue en marge des deux mouvements majeurs de l'époque Provoke et Kompora en cherchant à exprimer le côté mystérieux de la vie quotidienne en capturant l'extraordinaire de l'ordinaire. Avec Family Diary il saisit cette fois l'intimité de son propre foyer dans une grande simplicité, faites de gros plans, de portraits et d'images volées. Ce livre se termine par un texte écrit en 1993 par le photographe et qui permet de saisir l'intention avec laquelle il captura ces images à l'époque.
Bien d'autres acteurs de la scène underground japonaise mériteraient encore d'être mentionnés, nous vous invitons à poursuivre à travers l'ensemble des références proposées dans cette sélection !
Elodie
Le Japon d'après-guerre a vu ainsi exploser le nombre de musiciens, performeurs, danseurs, poètes, écrivains, artistes, photographes, réalisateurs attachés à faire émerger de nouvelles formes artistiques dans une visée pour le moins contestataire.
A l'exception de grandes études et/ ou de rétrospectives, il est encore assez rare que soit mis en avant ces œuvres et travaux d'avant-garde restés en toute logique confidentiels. Néanmoins, grâce à l'initiative de plusieurs acteurs du monde culturel ou de chercheurs, il existe désormais un nombre croissant de publications sur le sujet.
Avec cette sélection, nous avons eu envie de partager avec vous des ouvrages portant sur des courants artistiques ou des figures emblématiques de la contre-culture japonaise.
Publication de référence des Presses du réel, Introduction à l'esthétique est la première traduction en français d'un ouvrage de Nakai Masakazu par Michael Lucken, professeur à l'Inalco, historien et japonologue français. Nakai Masakazu est un philosophe et critique japonais de la première moitié du XXe siècle qui fit du politique et de l'artistique le cœur de sa pensée. Ses écrits se révèleront essentiels pour comprendre ce qui se joua au Japon dans les années 1910 à 1950 tout en permettant de saisir avec plus de facilité les mouvements contestataires japonais qui émergeront par la suite dans les années 1960.
Complémentaire, l'ouvrage Nakai Masakazu – Naissance de la théorie critique au Japon, publié quelques années plus tôt par Michael Lucken propose une étude sur le philosophe qui, comme nous le disions, marqua les mouvements de contre-culture des années 1960. A travers cette biographie riche et exigeante Michael Lucken procède à son tour à l'état des lieux de la pensée à l'époque moderne au Japon.
Figure incontournable de la contre-culture japonaise, Kazuki Tomokawa a vécu l'explosion de la scène artistique alternative dans les années 1970 à Tokyo. Musicien, peintre et poète, il publie en japonais en 2015 Try Saying You're Alive ! le récit de son quotidien, dans un genre qui mêle l'autobiographie et la fiction. Le livre sera traduit en anglais quatre ans plus tard. Il nous permet de découvrir le Tokyo alternatif de l'époque, électrisé par les rencontres, les concerts et les évènements en tous genres qui firent l'émergence de la scène underground d'après-guerre.
Autre personnalité hors-norme, le danseur et chorégraphe japonais Hijikata Tatsumi qui vécut dans le japon d'après-guerre et revendiquait sa proximité avec les opposants, les marginaux et les exclus. Créateur de l'ankoku butō (danse des ténèbres), ses créations mettaient en avant un corps meurtri et contraint qui entraient en résonnance avec les oppositions virulentes au régime politique d'alors. Il bouleversa la danse moderne en proposant des créations transgressives en excluant toute notion d'harmonie ou de beauté. Le recueil de texte du philosophe et traducteur Uno Kuniichi propose dans Hijikata Tatsumi – Penser un corps épuisé une analyse philosophique de l'œuvre de ce chorégraphe hors-norme en le rattachant à des figures comme Genet ou Artaud. Cet ouvrage est l'une des rares publications d'un ensemble de textes sur Hijikata rédigé et traduit en français.
Dans Pornologie vs capitalisme – Le groupe de happening Zero Jigen – Japon 1960-1972, Bruno Fernandès fait une étude du collectif, artistes performeurs, contemporain de Hijikata Tatsumi. Dans une veine ritualiste les actions subversives de Zero Jigen empreintes d'une forme d'obscénité, consistaient en des actions collectives qui se déroulaient principalement dans l'espace public . Cet essai est le premier réalisé en français sur le groupe d'avant-garde japonais qui sévit des années 1963 et 1972 au Japon.
En lien avec la scène musicale qui émergea à la fin des années 1970, l'ouvrage Japanoise de Jeremy Corral est un trésor pour ceux qui s'intéresse à la musique électronique et à la musique noise au Japon. Dans son livre, l'auteur fait une étude très précise du genre musical, un genre qui a bénéficié jusque-là de très peu d'analyses critiques en français. Il reconstitue brillamment l'histoire et les pratiques de ce mouvement tout en établissant les liens que le genre musical entretient avec les arts dits contemporains.
Phénomène majeur de l'histoire des avant-gardes et de la contre-culture au Japon depuis la fin des années 1970, la noise a longtemps été associée à une forme de provocation, d'excès et d'incompréhension. Toutefois, ce mouvement musical a exercé une influence particulière sur les scènes de musique underground du monde entier mais a jusque-là bénéficié de très peu d'analyses. Cet ouvrage exigeant et pointu recense comme nul autre la diversité des propositions dans le champ de la musique expérimentales au japon !
Micro Japon est quant à lui une compilation d'interview d'acteurs de la scène expérimentale au Japon réalisée par Michel Henritzi. Musicien, producteur et critique musical, lauréat de la Villa Kujoyama de Kyoto en 2007, Michel Henritzi a collaboré dans les années 1980 avec plusieurs groupes de rock industriel et a fondé le label AKT avec le collectif NOX. Sa grande connaissance en la matière lui permet de révéler la richesse de la scène musicale expérimentale nippone.
Publiée en 1968-1969, la revue Provoke a été la revue la plus caractéristique du renouveau de la photographie au Japon. Elle a permis à des photographes tels que Yutaka Takanashi et Daido Moriyama par exemple, de développer un nouveau langage photographique dont le radicalisme revoyait aux protestations étudiantes qui avaient lieu à l'époque. D'autres, tels que Issei Suda ou Nobuyoshi Araki développeront parallèlement de nouvelles formes propres et singulières qui s'imposeront tout autant.
Pour découvrir le travail de Daido Moriyama, parmi les nombreuses publications du photographe, il existe deux petits ouvrages caractéristiques de sa photographie. Intitulé Daido Moriyama, ce livre propose un ensemble de photographies de rue, instantanées, en noir et blanc et aux contrastes marqués. Brutes, floues, ou encore surexposées, ses images bancales et imparfaites deviendront représentatives de son travail et de l'approche révolutionnaire de certains photographes pour l'époque. Dans I take photographs ce sont à nouveau des photographies de portraits et de lieux, mêlant la couleur le noir et blanc cette fois, prises dans différents quartiers de Tokyo. A nouveau, le style de Daido Moriyama s'impose dans sa radicalité et confirme une nouvelle pratique de la photographie de rue.
Autre photographe qui a su s'imposer avec des images d'une grande singularité, Issei Suda. Egalement connu pour ses tirages en noir et blanc contrastés des rues nippones ou taïwanaises ce dernier évolue en marge des deux mouvements majeurs de l'époque Provoke et Kompora en cherchant à exprimer le côté mystérieux de la vie quotidienne en capturant l'extraordinaire de l'ordinaire. Avec Family Diary il saisit cette fois l'intimité de son propre foyer dans une grande simplicité, faites de gros plans, de portraits et d'images volées. Ce livre se termine par un texte écrit en 1993 par le photographe et qui permet de saisir l'intention avec laquelle il captura ces images à l'époque.
Bien d'autres acteurs de la scène underground japonaise mériteraient encore d'être mentionnés, nous vous invitons à poursuivre à travers l'ensemble des références proposées dans cette sélection !
Elodie